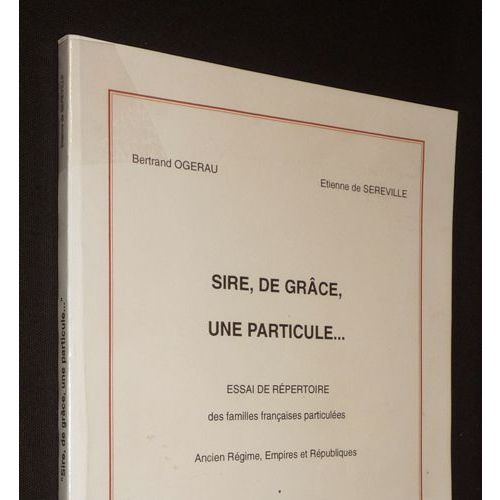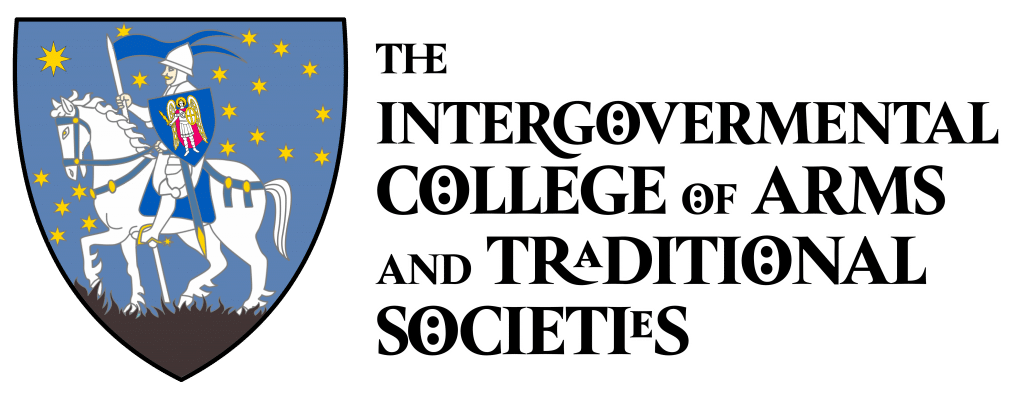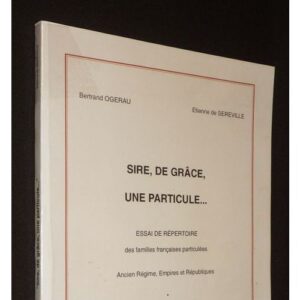Séance du lundi 3 juillet 2006
par M. Marc Guillaume, Maître des requêtes au Conseil d’Etat, Directeur des affaires civiles et du Sceau
Dans son titre, le directeur des affaires civiles et du sceau a l’honneur d’avoir en commun avec le Garde des Sceaux, l’usage du mot « sceau ». Dans le cas du ministre, ce terme est néanmoins utilisé au pluriel alors qu’il est au singulier pour le directeur. On pourrait voir là l’affirmation de la supériorité du ministre sur son subordonné. Cette explication est bien sûr exacte mais nécessite d’être précisée.
Dans le cas du Garde, le mot « sceaux » renvoie aux cachets qui scellent les lois. Le pluriel souligne que le ministre garde tous les sceaux, ceux des rois qui ont fait la France, ceux des Républiques passées et ceux de la Vème République. Cette variété des sceaux renvoie à la tradition ancienne selon laquelle chaque sceau de souverain était brisé à sa mort ou biffé à sa chute. On retrouve d’ailleurs toujours cette pratique du brisement dans celui de l’anneau du souverain pontife à la mort de celui-ci.
Après l’abolition de la monarchie et l’instauration de la République le 26 septembre 1792, la fin de l’ancien Régime fut symbolisée par le brisement des Sceaux de l’Etat et leur renvoi à la Monnaie par un décret des 6 et 8 octobre 1792. Pour autant la pratique du sceau du souverain ou du régime a bien sûr perduré. Il symbolise la permanence du régime, comme le chancelier la symbolisait déjà sous la royauté où pas plus que le dauphin il ne prenait le deuil du Roi défunt car « Royauté ni Justice ne passent ». Actuellement, le sceau de la Vème République est repris de celui de la IIème République dont seule la date a été effacée de la matrice originale.
Pour n’en dire qu’un mot, on peut relever que cette reprise du Sceau de 1848 est à la fois symbolique et porteuse de quelques bizarreries. L’arrêté du 8 septembre 1848 disposait que le sceau de l’Etat portera d’un côté, pour type, la figure de la liberté et pour légende « au nom du peuple français », de l’autre côté une couronne de chêne et d’olivier, liée par une gerbe de blé ; au milieu de la couronne « République française, Démocratique, une et indivisible » et pour légende « Liberté, Egalité, Fraternité ». Ces prescriptions n’ont pas été rigoureusement observées par l’Artiste (Barré) qui a inversé les légendes du recto et du verso et qui a ajouté une grappe de raisin à la gerbe de blé.
Surtout on peut relever que si ce sceau est celui actuellement utilisé, l’inscription « République française, démocratique une et indivisible » n’est pas conforme à celle énoncée par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (« la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »). Pourtant on utilise toujours le Sceau de 1848.
Si, dans le cas du Garde, le mot « Sceaux » renvoie donc au cachet, dans le cas du directeur, le mot « Sceau » renvoie aussi au grand livre du Sceau dont j’ai apporté ici le 8ème volume. Or, depuis l’Empire, de la Restauration à la IIème République, du second Empire à la IIIème République et jusqu’à nos jours, il n’y a jamais eu qu’un seul livre du sceau. C’est ce qui explique le singulier dans le titre du directeur. De Benardy, premier titulaire du poste en 1813, au 56ème et actuel directeur.
Qu’il soit utilisé au singulier ou au pluriel, le mot « sceau » a bien sûr la même signification. Dans les deux cas il s’agit d’authentifier. Pour le ministre, il s’agit d’authentifier les lois. La tradition demeure sous la Vème République où onze lois ont été scellées par le ministre. Toutes ces lois étaient des lois constitutionnelles à l’ exception de la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort. Au sens juridique, cette loi était une loi ordinaire. Mais elle sortait bien sûr de l’ordinaire ce qui expliqua la décision du Garde de la sceller.
Je ne résiste pas au plaisir de vous indiquer qu’à l’occasion du scellement de ces textes, le directeur des affaires civiles prend des réquisitions et pas n’importe lesquelles puisque, selon la formule, il requiert qu’il plaise au ministre de bien vouloir apposer le Grand Sceau de la République française.
Si la fonction d’authentification est pour le ministre relative aux lois, elle est pour le directeur relative aux titres nobiliaires. Ce sont en effet ceux-ci qui sont aujourd’hui authentifiés et transcrits dans ce Grand Livre. Ils le sont après une instruction au sein de la Section du Sceau de la direction qui a également en charge les changements de nom et les mariages posthumes. C’est à l’histoire de cette section et à l’actualité de ces deux premières missions qu’André Damien a bien voulu me demander de consacrer mon intervention de ce jour.
Je voudrais dire avant d’y procéder combien je suis honoré de le faire et combien la tâche est lourde. D’abord, bien sûr, parce que M. Jean Foyer, en tant que Garde des Sceaux et M. Denoix de Saint-Marc, en tant que directeur des affaires civiles et du sceau, ont traité ces questions avec le soin que vous imaginez. J’en ai retrouvé maintes traces dans les archives de la direction : ils ont veillé au grain pour que la Section du Sceau, à travers les investitures et les changements de noms, permette à notre présent d’être le digne héritier de notre histoire. L’autre difficulté est qu’André Damien connaît mieux que moi le sujet dont je viens vous parler. J’ai donc un peu l’impression qu’aujourd’hui, tel le maître, il vient ramasser la copie de l’élève. La tâche, vous le voyez, n’est pas simple.
L’investiture des titres nobiliaires : histoire et actualité
Dans un premier temps, je voudrais donc évoquer avec vous l’investiture des titres nobiliaires. Avant d’aborder le droit actuel de ces investitures, il m’a paru nécessaire de revenir sur l’histoire des titres et de la Section du Sceau de France.
Rappel historique sur les titres nobiliaires et la Section du Sceau de France
Les titres nobiliaires
L’histoire des titres est en effet fondamentale puisque la seule question aujourd’hui est celle de la transmission des titres obtenus dans le passé. Il serait trop long de détailler ici les différences entre les titres selon le régime qui les a conférés, entre la noblesse d’Ancien régime, titrée ou non ; la noblesse d’Empire toujours titrée, la noblesse de la Restauration et de la Monarchie de juillet et les titres du second Empire. Il convient néanmoins de rappeler comment ces titres ont été acquis avant de voir comment ils se transmettent aujourd’hui.
On sait que sous la royauté, la noblesse de concession était celle qui avait été octroyée par le souverain à une époque déterminée. Les premiers titres de noblesse ont été décernés au XIIIème siècle par Philippe III le Hardi. Seuls les nobles pouvaient être titrés mais tous ne l’étaient pas. Les lettres d’anoblissement prenaient la forme de lettres dites patentes.
Les termes de ces lettres sont fondamentaux puisqu’ils prévoient les règles de transmission du titre. Normalement celle-ci s’opère de mâle à mâle, par ordre de primogéniture. Mais on voit certains titres bénéficier à tous les descendants mâles, aînés ou puînés. Tels sont les titres du Saint Empire, du duché de Lorraine, avant l’annexion. Dans les familles de Broglie et de Bauffremont, par exemple, tous les enfants sont princes du Saint-Empire, l’aîné seul était duc.
La collation d’un titre par le Roi était totalement discrétionnaire. Mais elle était soumise, conformément à l’édit d’Amboise pris par Henri II le 26 mars 1555, à l’exigence de son enregistrement par une ou plusieurs cours. Cette double condition perdura jusqu’à la Révolution.
Après les lois du 4 août 1789, une loi des 19 et 23 juin 1790 proclama que : « les titres de prince, duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chancelier, messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables ne seront ni pris par qui que ce soit, ni donnés à personne ».
Cette abolition des titres d’Ancien Régime perdura sous le 1er Empire. Napoléon Ier institua alors une noblesse d’Empire ou plus exactement décerna des titres impériaux. Les premiers le furent par le Sénatus Consulte du 18 mai 1804. Le 1er mars 1808, deux statuts furent édictés régissant les titres impériaux et les majorats. Le majorat était une somme d’argent attachée au titre. Si ces revenus étaient constitués par la libéralité de l’Empereur, c’étaient des majorats de premier mouvement. S’ils étaient produits par des biens appartenant à un particulier, c’étaient des majorats sur demande. Pour être transmissible, les bénéficiaires des titres devaient constituer ce majorat produisant des revenus : pas de titre héréditaire sans majorat.
Sous le 1er Empire, si l’on fait abstraction des titres souverains considérés comme étrangers, quatre titres de prince ont été créés (Davout, prince d’Eckmül, Berthier prince de Neuchâteau et de Wagram, Massena prince d’Essling, Ney, Prince de la Moskova). 32 titres de ducs ont été créés, 388 titres de comtes et 1090 titres de baron (cf 1er volume du livre du Sceau).
Lorsque Louis XVIII monta en 1814 sur le trône de ses ancêtres, il octroya une charte dont l’article 71 disposait que : « La noblesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exception des charges et des devoirs de la société ». L’anoblissement était ainsi rétabli sans être obligatoirement lié à l’octroi d’un titre. Ce droit fut conservé après les 100 jours.
La Seconde République, dans l’un de ses premiers actes, abolit tous les titres de noblesse et la noblesse elle-même par un décret du 23 février 1848. Il fut même interdit de faire publiquement usage de ces titres. La Constitution de novembre 1848 devait, dans son article 10, reprendre et confirmer cette double abolition.
Mais Louis-Napoléon Bonaparte revint immédiatement sur cette abolition et abrogea le décret du 29 février 1848 par un décret du 24 janvier 1852. La noblesse se retrouvait donc dans l’état où elle était sous Louis-Philippe.
La dernière évolution du droit des titres se fit sous la IIIème République. Mac-Mahon décida le 10 mai 1875 de ne plus créer de nouveaux titres nobiliaires. Seules les transmissions de titres continueraient de faire l’objet d’arrêtés officiels. Ceux-ci demeurent donc régis respectivement par le droit d’ancien régime ou par le décret du 1er mars 1808. C’est cet état de droit qui a perduré depuis lors, à travers la section du Sceau de France dont il faut dire quelques mots.
La Section du Sceau de France
En même temps qu’il créa la noblesse impériale, Napoléon Ier créa le Conseil du Sceau et des titres par décret du 1er mars 1808. Ce Conseil était alors chargé de se prononcer sur toutes les demandes relatives aux titres, changements de nom, armoiries. L’Empereur créa aussi les référendaires du Sceau de France ainsi qu’un monopole obligatoire pour les avocats au Conseil d’Etat, seuls habilités à introduire les dossiers auprès des référendaires, lesquels présentaient les demandes à l’Empereur.
La Restauration, par l’ordonnance du 15 juillet 1814, conserva une Commission du Sceau pourvue d’attributions analogues. Les référendaires et le Conseil du Sceau furent finalement supprimés sous la IIIème République et remplacés par décret du 10 janvier 1872 par le Conseil d’administration du ministère de la justice composé de la réunion des 6 directeurs de la Chancellerie.
Aujourd’hui le Conseil d’administration vient de perdre sa compétence aux termes du décret du 27 mai 2005. Celui-ci a en effet modifié le décret du 10 janvier 1872 et retiré toute attribution, en matière de titre, au Conseil d’administration pour consacrer la compétence, par délégation du ministre, de la direction des affaires civiles. Cette réforme prend en compte la réalité, la tradition voulant que le directeur proposait une décision au ministre, l’examen par le Conseil d’administration étant purement formel et étant même fait par écrit ces derniers temps.
Au sein de la DACS, la section du Sceau de France instruit les demandes d’investiture et présente un rapport au Garde. Celui-ci décide par un arrêté motivé d’investiture ou de rejet. Cet arrêté n’est pas publié au Journal Officiel. Il est inscrit sur le registre du sceau « in extenso » et une ampliation en est délivrée au requérant.
L’investiture des titres nobiliaires au XXIème siècle
Le régime juridique de l’investiture
La section du sceau procède aujourd’hui seulement à la vérification des titres nobiliaires. Cette vérification, appelée investiture, consiste à établir que le titre est régulier, qu’il a été transmis selon les règles de dévolution prévues par les lettres patentes de concession et que le titulaire actuel de ce titre est bien le descendant régulier du premier titulaire du titre.
Ainsi la reconnaissance par la République des titres de noblesse est purement formelle. Elle se contente de constater que telle personne est la mieux placée pour succéder au titre dont un ancêtre est décédé titulaire.
L’utilité de cette investiture est claire : le titulaire d’un titre nobiliaire ne peut faire légalement usage de celui-ci dans les actes officiels que s’il justifie d’un arrêté d’investiture du Garde des Sceaux (ou éventuellement d’une décision judiciaire). Certes l’investiture n’est pas obligatoire pour la transmission du titre mais le défaut d’investiture empêche le porteur du titre d’en faire un usage officiel.
Le titre nobiliaire a ainsi un double caractère :
- C’est un élément d’état civil et il doit être mentionné sur les actes par l’officier de l’état-civil si celui-ci a la preuve de son existence et de sa transmission ;
- Sa vérification est un acte de puissance publique.
Un arrêt du tribunal des conflits du 17 juin 1899 (de Dreux Brézé S.1900.3.17 note Hauriou) a tiré les conséquences de cette dualité et établi le partage de compétence juridictionnelle suivant :
- La juridiction administrative a compétence pour vérifier les titres de noblesse,
- mais il appartient à la juridiction judiciaire de « connaître des actions fondées sur de prétendues atteintes aux droits pouvant résulter pour ceux qui les ont obtenus, des titres de noblesse régulièrement conférés ».
En application de cette jurisprudence du tribunal des conflits, le Conseil d’Etat a décidé par un arrêt du 29 avril 1910 de Martimprey, rendu conformément aux conclusions du président Corneille, que la compétence était administrative toutes les fois qu’était soulevée une question touchant la validité, le sens ou la portée des actes de la puissance souveraine qui ont donné ou confirmé le titre nobiliaire. Depuis lors, on trouve plusieurs autres décisions : CE, 31 janvier 1936 de Potier. p147 ; CE, 19 décembre 1947, Drouilhet de Sigalas, p 478 ; 4 février 1949 de Cossé duc de Brissac, p 53 ; 6 avril 1979 Chillou de Saint Albert, p 148 ; Cour de Cass. 3 août 1908.
Depuis les débuts de la procédure d’investiture et la décision du président Mac-Mahon le 10 mai 1875 jusqu’à aujourd’hui, 376 familles françaises ont bénéficié d’un arrêté du Garde des Sceaux d’investiture de leur titre.
112 de 1880 à 1900
80 de 1900 à 1918
59 de 1918 à 1940
7 de 1940 à 1945
39 de 1948 à 1970
39 de 1971 à 1999
2 en 2002
Le chiffre de presque 4 centaines d’investiture en 130 ans est réduit. Le rythme des investitures va décroissant chaque décennie. Bien sûr, il convient de relativiser cette évolution car le descendant du premier titulaire peut toujours se faire investir même si ses ascendants ont négligé de le faire. Cependant cette tendance lourde traduit également la réduction progressive des titres valablement portés. Ainsi, pour les seuls ducs héréditaires (et non de la famille royale) on peut rappeler qu’un peu plus de 200 titres furent créés (141 sous l’Ancien Régime, 32 sous le 1er Empire, 26 sous la Restauration)…. Il n’en demeure qu’une trentaine aujourd’hui, les autres s’étant éteints faute de transmission. Il ne resterait ainsi que trois titres de ducs d’Empire : Montebello (Maréchal Lannes – 1808) ; Rivoli (Maréchal Massena, 1808) ; Albufera (Maréchal Suchet, 1812).
Pour obtenir l’investiture, tout requérant doit produire des lettres patentes de concessions ou un décret de confirmation postérieur à la Révolution. Il y a un siècle, le conseil du Sceau avait pu admettre qu’une longue possession d’état pouvait suppléer l’absence des les lettres patentes. Cette possibilité est aujourd’hui exclue.
* Pour les titres d’Ancien Régime, le requérant doit établir que le titre s’est transmis du premier titulaire jusqu’à lui suivant les modalités prévues par les lettres patentes. En conséquence, cette transmission va le plus souvent s’opérer de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans l’affaire relative au titre du baron d’Huart (Section, 25 février 1983, Ccl. Genevois) où a été débouté le requérant revendiquant la possession de ce titre par une transmission féminine autorisée par une loi étrangère telle qu’elle était reproduite dans les lettres patentes du roi d’Espagne du 19 juillet 1709.
Ces dernières années, le ministre de la justice a, par arrêté préparé par la Section du Sceau, fait droit à plusieurs requêtes en investiture de titres d’ancien régime : le marquis de Terraube (1986), le Marquis de la Charce (1993), le vicomte de Quincy (1993), le duc de Mortemart (1995), le duc de Lorge (1999).
* Pour les titres du Premier Empire, leur dévolution doit s’opérer conformément aux décrets du 1er mars 1808. On a rappelé que cette transmission était subordonnée à la constitution de majorats. Or seulement 15 % environ des titres impériaux ont été accompagnés de majorats et ont donc pu être légalement transmis. Pour l’investiture d’un titre d’Empire, la section du Sceau vérifie donc non seulement les ordonnances et les lettres patentes mais l’existence des majorats. Il est cependant admis que les premiers titulaires d’un titre du Premier Empire qui n’avaient pas constitué de majorats et qui sont décédés après le 12 mai 1835 ont pu valablement transmettre leur titre à leurs descendants. Les intéressés ont, comme il est dit, été « surpris » par la loi de 1835. Ils purent donc transmettre leur titre à leurs descendants. Une décision a été rendue en ce sens le 23 mai 1846 dans une affaire de titre de baron par le Conseil du Sceau.
Dans les 40 dernières années, la Chancellerie a fait droit à plusieurs requêtes en investiture de titre de Premier Empire. Ainsi furent investis le Duc Régnier de Massa (1949), le Baron Suisse de Saint-Claire (1962), le Comte Daru (1971) Massena Prince d’Esling (1976), le Comte Portalis (1984), le Baron Pinoteau (1993).
Deux titres de la Restauration ont été également récemment investis : le Baron Oberkampf (2002) et le Baron Le Barrois d’Orgeval (2002).
* Quelques mots enfin sur la IIIème République. J’ai rappelé que le maréchal de Mac-Mahon décida de ne plus créer de nouveaux titres nobiliaires par une décision du 10 mai 1875. Se posa aussi la question des titres étrangers. Il existait en effet un décret du 5 mars 1859 qui disposait que les titres conférés à des Français par des souverains étrangers ne pouvaient être portés qu’avec autorisation du Chef de l’Etat. Mac-Mahon autorisa le port en France et par des Français, mais à titre uniquement viager, de sept titres romains (dits du Pape) et d’un titre de la République de Saint Marin. Ainsi, par exemple, par décret du 19 juin 1877, du Comte Espivent de la Villeboisnet. Puis il fut décidé de ne plus faire usage du décret de 1859 néanmoins non abrogé. Le Gouvernement s’engagea en ce sens à la chambre des députés par une déclaration du 14 décembre 1906.
En effet la reconnaissance de titres étrangers fut considérée, comme équivalent à la création d’un titre nouveau incompatible avec les institutions républicaines. Une telle règle simple méritait bien sûr des exceptions. Il n’y en eut que deux depuis lors. La première apportée par le président Carnot en 1893, là encore de manière viagère, au profit du Comte romain Lefebvre Pigneaux de Behaine. La seconde fut celle apportée en 1961 par le général de Gaulle en faveur de M. de Levis-Mirepoix autorisé à porter le titre espagnol de duc de San-Fernando-Luis, auquel est attaché la grandesse d’Espagne. En ce sens, ce titre avait déjà été conféré, sous la Restauration, à son ancêtre, Adrien de Montmorency, prince de Laval par le roi d’Espagne Ferdinand VII.
Quelques questions de droit
La transmission d’un titre en ligne collatérale
Les titres d’ancien régime se transmettent « de mâle en mâle et par ordre de primogéniture ». S’est donc posée la question de savoir si cette expression « de male en male et par ordre de primogéniture » devait être interprétée dans le sens d’une transmission exclusive de père en fils ou bien uniquement comme ayant pour objet d’exclure de la succession au titre, toute personne dont le degré de parenté avec le de cujus ne peut être établi qu’en remontant à une souche commune antérieure à la création du titre (ce cas étant par exemple analogue à celui de Henri IV dont la parenté avec son prédécesseur Henri III ne s’établissait qu’en remontant à Saint-Louis, soit antérieurement à l’avénement des Valois).
Très rapidement, pour les titre impériaux, a été retenue la vocation d’un collatéral descendant du premier titulaire (Roger, 10 mars 1882 ; Marulaz 2 mars 1933). En revanche, le Conseil d’administration du ministère, sur le fondement d’une interprétation stricte de l’ordonnance du 11 janvier 1818, avait refusé cette orientation pour les titres de la Restauration. Le Conseil d’Etat a annulé sa décision pour fausse interprétation des textes (31 janvier 1936, de Potier ; Drouilhet de Sigalas arrêté d’investiture du 2 juillet 1950).
La même solution fut adoptée pour les titres d’ancien régime. Le Garde des Sceaux Jean Foyer pris en ce sens un arrêté du 3 octobre 1962 relatif au marquis de la Charce. La branche aînée de la famille, issue du premier fils du marquis de la Charce né en 1655 venant de s’éteindre, l’arrêté attribue le titre au descendant de la branche cadette issue du fils né en 1658. René Pléven fit de même par l’arrêté du 1er juin 1972 relatif au titre de duc de Clermont-tonnerre.
Sur la transmission du titre à un enfant adopté
Distinguons les titres d’Ancien Régime et les titres du Ier Empire. En effet on sait que sous l’Ancien Régime, l’Adoption n’existait pas alors qu’elle a été reconnue sous Napoléon.
Napoléon Ier avait prévu dans diverses lettres patentes que le titre serait transmissible dans la postérité « légitime, naturelle ou adoptive ». Dès lors, le titre est aujourd’hui transmissible à un enfant adopté. L’ancienne condition de l’agrément par le souverain de ce transfert de titre n’a plus d’objet. C’est ce que Jean Foyer avait prédit devant l’Assemblée nationale lors des débats de la loi du 16 juillet 1966 sur l’adoption. On comprendrait en effet mal comment saisir le Chef de l’Etat d’une demande tendant à faire produire à l’acte d’adoption un effet dévolutif du titre.
C’est ce que vient de confirmer la Chancellerie au sujet de duc de Reggio successeur du Maréchal Oudinot (1810). Par un arrêté du Garde des Sceaux du 12 septembre 2003, ce titre a été conféré au fils adoptif aîné du duc. Son frère puîné, également adoptif, reconnaît la transmissibilité à un enfant adopté mais a attaqué l’arrêté devant le juge administratif pour d’autres motifs.
Pour les titres d’ancien régime, ces titres se transmettaient de plein droit, en ligne directe masculine. Peuvent-ils dès lors se transmettre aujourd’hui à un enfant adopté ? La question a été longtemps débattue.
De rares jugements anciens étaient contradictoires mais la doctrine admettait généralement que la transmission des titres nobiliaires pouvait s’opérer en faveur de l’adopté. En effet l’assimilation actuelle de la filiation adoptive à la filiation par le sang semble devoir conduire à ne pas distinguer parmi ces enfants pour l’investiture du titre. Au demeurant, l’adopté se voit attribuer le nom de l’adoptant et le titre, en tant qu’accessoire du nom, doit alors se transmettre de plein droit à l’adopté. En outre contrairement à la règle de la transmission par les males, il n’existe pas de règles contraires dans le droit ancien. Celui-ci doit être interprété restrictivement, comme le rappelait le président Genevois dans ses conclusions sous l’arrêt Huart.
Sur la base de ces différents éléments, le Garde des Sceaux a pris un arrêté du 30 avril 1987 relatif à l’investiture du marquis de Vibraye au profit du fils adoptif de celui-ci Charles Hurault de Vibraye, né Charles Drouilhet de Sigalas (adoption plénière par jugement définitif du 12 juillet 1968). Dans le même temps, un refus a été opposé en cas d’adoption simple au sujet de l’investiture du titre de duc de Fitz-James.
Situation particulière des maisons souveraines ayant régné sur la France.
Les membres des maisons souveraines ayant régné sur la France (Bourbon, Valois, Napoléon) disposent de la qualification de prince. Cette qualification constitue pour les intéressés, moins un titre, au sens du droit nobiliaire, qu’une qualité par laquelle se reconnaissent les membres des familles ayant régné sur la France. Ce ne sont pas des titres héréditaires décernés par un souverain régnant par lettres patentes, au contraire des quatre maréchaux d’Empire, auxquels Napoléon Ier a décerné le titre de Prince.
Distinctes des titres de noblesse, ces appellations portées par les anciennes familles régnantes sur la France ne sont pas soumises au même droit. Non héréditaires, elles n’ont pas à être vérifiées par le Garde des Sceaux. Elles sont à la discrétion de leur titulaire.
Pour les exercer, ce titulaire se fonde sur les règles anciennes, aujourd’hui abrogées, mais ayant valeur coutumière pour le chef de famille. C’est ce qui explique que ces règles puissent être différentes pour la famille de Napoléon Ier et pour les autres familles régnantes. Sous le 1er Empire, le droit d’aînesse n’a, par exemple, pas la même valeur absolue que dans d’autres cas. De même sont exclus les membres qui ont contracté des mariages non dynastes, c’est à dire sans l’accord de celui considéré comme le chef de famille. C’est ce qui avait conduit Napoléon Ier à exclure de la succession le roi Jérôme qui avait contracté le mariage Paterson.
Pour autant le Prince impérial ne peut être choisi que dans les descendants de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes, ce qui est par exemple le cas des Princes Murat qui, bien que descendants de la reine Caroline, sœur de l’Empereur, sont inaptes par l’effet de la loi salique à la vocation impériale.
Toutes ces règles ont récemment conduit le Prince Napoléon, dans son « testament politique » du 27 mai 1996, à désigner comme héritier dynaste pour lui succéder à la dignité impériale son petit-fils et non son fils. Maître Jean-Marc Varaut avait détaillé cette décision et ses fondements dans un communiqué du 24 novembre 1997. La section du Sceau a, dans ces situations, toujours renvoyé les intéressés à la volonté du titulaire, se refusant à exercer un contrôle qui ne lui revient pas.
Au delà de la qualification de prince, il en va de même par exemple pour les titres portés dans la famille d’Orléans. Ainsi Jean d’Orléans, duc de Guise, donna à son fils Henri d’Orléans le titre de comte de Paris. Celui-ci conféra en 1957 à Henri son premier fils, né en 1933, le titre de Comte de Clermont en Beauvaisis. Ce titre féodal appartint à Saint-Louis et fut attribué en 1814 au prince de Condé. Le second fils du comte de Paris, Michel, fut fait comte d’Evreux par son père en 1976, titre remontant à 1037 et à la maison des ducs de Normandie.
On voit par ces deux exemples que ces titres créés ne sont en rien des titres de noblesse transmis. Ils ne sont pas soumis au même droit.
* Des dotations sans titre ont également été accordées par Napoléon Ier essentiellement au profit des familles des soldats morts à Austerlitz et aux compagnes suivantes. La dévolution de ces dotations est réglée par le décret du 14 octobre 1811. A ces dotations avaient été affectées des actions sur les canaux (canal du midi confisqué à la famille de Riquet de Camaran, canal d’Orléans et du Loing confisqué à la famille d’Orléans. La dévolution de ces dotations fait toujours l’objet d’un arrêté de rejet ou d’investiture du Garde des Sceaux, préparé par la section du Sceau (Rostagnat inscription du 6 février 1933 transmission en ligne collatérale d’une dotation sur le canal de Loing, conformément à la jurisprudence Roger). Une loi du 10 janvier 1942 avait prévu de mettre fin à ces dotations tout en sauvegardant les droits des dotataires par rachat de l’Etat. Cette réforme n’a pu être mise en œuvre durant la guerre. Elle concernerait une trentaine de personnes bénéficiaires de dotation sur les canaux d’Orléans et du Loing, les rentes sur le canal du midi semblant toutes éteintes.
L’égalité entre l’homme et la femme
Cette égalité a-t-elle des conséquences en matière de port et de transmission des titres ? Par définition non, puisque le titre nobiliaire n’obéit pas aux règles du code civil mais au droit applicable à l’acte de création du titre.
Le droit d’ancien régime est, à cet égard, moins ennemi des femmes qu’on le croit parfois. Tout d’abord, il les a parfois directement titrées, créant ainsi directement des femmes Duchesses (Diane de Poitiers, Louise de la Vallière, Madame de Chateauroux). Surtout, si l’acte prévoit des règles particulières de transmission aux femmes, celles-ci s’appliquent.
Ainsi le duché de Mazarin, créé en 1663 au bénéfice de l’époux d’une nièce du cardinal, pouvait être transmis dans la postérité féminine du premier titulaire. Il en allait par exemple de même, initialement, pour le duché de Chevreuse, aux termes des lettres patentes signées par Louis XIV en 1667 (« au profit du titulaire et de ses enfants tant mâles que femelles »).
Par ailleurs, le titre est parfois transmissible à toutes les descendantes non mariées de celui à qui le titre avait été conférée. Dans les familles de Broglie et de Braufremont, par exemple, toutes les filles non mariées sont princesses. Certains titres conférés par Napoléon III prévoyaient, quant à eux, qu’ils pouvaient être transmis par les femmes « sous réserve de confirmation par le souverain ». C’est ce à quoi ont procédé quelques décrets du Président de la République.
Pour les titres d’Ancien régime, il est en revanche constant que le titre de la femme est intransmissible au mari et à ses enfants. Dans le même temps ; il a toujours été admis que la femme a le droit de porter le titre de son mari, elle le féminise en le prenant. Ce droit est en quelque sorte un accessoire du mariage, un simple droit personnel et viager et non un droit réel sur le titre lui-même. En conséquence, la Cour d’appel de Paris, en 1998, a interdit l’usage du titre de duchesse de Magenta à l’ex femme du duc. Cependant, en présence d’un intérêt particulier pour les enfants, la Cour a autorisé l’intéressée à « user du nom marital limité au nom patronymique, à l’exclusion du nom et du titre de Duchesse de Magenta ». Un arrêt de la même année de la Cour d’appel de Bourges tranche la question dans le même sens à l’encontre de l’ex-femme du duc de Clermont-Tonnerre.
* * *
La reconnaissance des titres nobiliaires par leur investiture n’emporte pas, bien sûr, pas elle-même la reconnaissance de la noblesse. C’est bien ce distinguo qui a permis à cette procédure héritée de la IIIème République naissante, où les royalistes tiennent une forte place, de perdurer jusqu’à nos jours. Certes des tentatives de suppression des investitures se firent jour en 1882 et 1890. Il en avait été encore ainsi en 1948 où l’investiture fut sauvée par le ministère des finances opposé à la disparition des recettes procurées par la perception des droits de sceau auxquels étaient alors assujettis les demandes de reconnaissance de titre. Ces droits ont aujourd’hui disparu.
Demeure la procédure d’investiture apparemment peu conforme à notre République. Cependant celle-ci permet d’assurer la régularité et l’incontestabilité de la transmission de distinctions accordées pour récompenser de signalés service par les anciens régimes de la France. Convenons que la France, seule et unique, la madone des comtes ou la princesse aux fresques des murs, gagne à cette persistance.
Le changement de nom
Nous ne traiterons ici que des changements de nom en dehors de tout lien de filiation qui sont les seuls qu’a à connaître la Section du Sceau. Là encore pour évoquer le régime actuel de changement de nom, il faut débuter par un retour historique en arrière.
L’immutabilité du nom n’est pas une innovation révolutionnaire. Les noms de famille semblent être devenus héréditaires à partir du XIIIème siècle sous le règne de Philippe Auguste. Pour autant, les tentatives ou les tentations de changement de nom étaient déjà légion, notamment de la part de bourgeois gentilshommes aspirant à l’anoblissement par l’adjonction d’un nom de terre au nom originaire. On se souvient des vers de Molière :
« Je sais un paysan qu’on appelait « Gros-Pierre ».
Qui n’avait pour tout bien que deux lopins de terre,
Y fit faire à l’entour un fossé tout bourbeux
Et de Monsieur de l’Isle, prit le nom pompeux. »
Face à ce mouvement, les rois rappelèrent avec constance qu’ils avaient seuls le pouvoir, par des lettres royales, de valider des changements de noms. Il semble que ce soit le roi Louis XI qui ait fixé cette procédure le premier et l’ai inaugurée. Il permet en 1471 à son « cher et bien aimé valet de chambre Oliver Le Mauvais (de) se surnommer, lui et sa postérité, Le Daing, sans que nul ne puisse le surnommer Le Mauvais, lequel est ôté ». Puis Louis XI permet en 1474 à son notaire Jean Decaumont de substituer à son patronyme celui de « De Chaumont ». On le voit avec ces deux types de substitution : tout est déjà dit il y a 6 siècles et, aujourd’hui encore, les demandes ont toujours principalement ces objets de commodité ou de vanité.
L’édit d’Amboise du 26 mars 1555, puis l’ordonnance de janvier 1629 dite « Code Michau » confirmèrent cette immutabilité du nom sous réserve de décision royale. Il faut cependant garder en tête que ces ordonnances restèrent d’application limitée puisque nombre de Parlements refusèrent de les enregistrer.
La Révolution allait, en deux temps, mettre un terme à ces pratiques. Initialement, le décret du 24 brumaire au II (14 novembre 1793) permettait à tout le monde de changer de nom à volonté. Mais, rapidement, la loi du 6 fructidor au II a posé dans son article 1er que « Aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ».
Cette immutabilité du nom patronymique a été tempérée dès la loi du 11 germinal au XI, prévoyant une procédure dérogatoire en trois temps : une demande motivée au Gouvernement, une publication au « Bulletin des Lois » pour permettre aux opposants de se faire connaître, enfin un décret au Conseil d’Etat.
Cette procédure n’a guère changé entre la Révolution et la loi du 8 janvier 1993. Seuls des textes particuliers sont intervenus pour différentes catégories de citoyens : décret du 20 juillet 1808 relatif aux Israélites, loi du 2 juillet 1923 pour le relèvement des noms des morts pour la France, ordonnance du 2 novembre 1945 et textes subséquents pour la francisation des noms des naturalisés.
La loi du 8 janvier 1993, prise sur le rapport de M. le Sénateur Dejoie, a abrogé la loi du 11 germinal en XI et supprimé la consultation du Conseil d’Etat. Celui-ci reste néanmoins le juge vigilant des décrets de changement de nom.
La loi du 8 janvier 1993 a inséré dans le code civil un article 61 dont l’alinéa 1er est ainsi rédigé : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». Je ne m’attacherai pas ici à détailler la procédure de changement de nom, mais seulement à analyser le nécessaire « intérêt légitime » de cette demande.
Cette analyse peut être éclairée par quelques chiffres sur les changements de nom et l’activité de la Section du Sceau. Celle-ci est actuellement saisi d’environ 1400 demandes de changement de nom par an, soit un doublement du nombre d’affaires depuis 1990. Il est fait droit à plus des trois-quart de ces demandes et un petit quart est rejeté (263 rejets en 2004, 320 rejets en 2005).
Ces décisions de changement de nom donnent lieu à une quarantaine de décrets par an. Une soixantaine de refus (sur 300) conduisent à des contentieux.
35 % des demandes sont introduites sur la base de la francisation de nom (483 sur 1401 en 2005),
20 % des demandes le sont au motif que le nom est difficile à porter (274 sur 1401)
18 % de demandes le sont en raison de problèmes liés à la famille (251 sur 1401)
9 % des demandes le sont pour relever le nom (121 sur 1401).
La justification d’un intérêt légitime
Pour changer de nom, il faut aux termes de l’article 61 du code civil, disposer d’un intérêt légitime. Toutefois, aucune définition n’est donnée de celui-ci puisque le Sénat a supprimé du projet de loi en 1993 la liste indicative des cas pouvant justifier une demande de changement de nom. L’alinéa 2 de l’article 61 se borne à préciser une situation :
« La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4ème degré ».
En l’absence de définition de l’intérêt légitime, celui-ci a été défini au fil du temps par le Conseil d’Etat, tant au contentieux que surtout, préalablement, lorsqu’il était consulté dans ses formations administratives sur toute demande de changement de nom. M. Daniel Pepy et M. François Bernard ont fait en 1967 et 1978, dans Etudes et Documents, un panorama complet de cette action du Conseil d’Etat.
La francisation d’un nom à consonance étrangère
Ces demandes sont totalement distinctes de celles fondées sur la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms à l’occasion de l’acquisition de la nationalité française. Elles traduisent néanmoins la même volonté de s’intégrer encore davantage dans le communauté nationale. Elles sont donc accueillies libéralement. La Section du Sceau ne les rejette pratiquement jamais, même lorsque, comme le soulignait François Bernard, elles conduisent à voir disparaître des noms illustres (Abd El Kader).
L ‘exemple récent de M. Baïri souligne ce libéralisme.
M. Baïri a déposé en 2004 une demande de changement de nom. Il voulait ne plus porter un nom à consonance étrangère afin de parfaire son intégration. Il demandait à porter le nom de sa grand-mère maternelle qui se nommait d’Artagnan.
Le Garde des Sceaux a fait droit à cette demande par décret du 26 mars 2004. Le sénateur Aymeri de Montesquiou Fezensac, issu de la famille Montesquiou Fezansac d’Artagnan Montluc, a attaqué ce décret devant le Conseil d’Etat, comme le permet la jurisprudence « Consorts de Saint-Martin » (9 juin 1978). La Haute Assemblée a rejeté ce recours par une décision du 28 octobre 2005. D’une part, elle a jugé que M. Baïri « eu égard à l’origine étrangère de son nom patronymique justifiait d’un intérêt légitime à demander l’autorisation de porter un autre nom ». D’autre part, elle a estimé que « le risque de confusion allégué par le sénateur n’était pas établi dès lors qu’il ne portait pas le patronyme d’Artagnan ». Elle en a déduit « qu’en dépit de la rareté de nom dont il s’agit et de l’illustration qui lui a été donnée par plusieurs personnes qui l’ont porté, le préjudice invoqué par le sénateur ne peut être regardé comme suffisant ». Ceci prolonge la jurisprudence Abbé Laurentin (CE, 21 mars 1997).
Au delà de l’intérêt de cette espèce quant au nouveau nom retenu, elle souligne que la subjectivité de l’appréciation de la consonance étrangère du nom initial conduit à peu de rejet. La Section du Sceau et le Conseil d’Etat sont en la matière sur la même ligne libérale. On trouve, ces dernières années, une seule décision d’annulation, le nom Brauner n’ayant pas selon le Conseil une consonance étrangère justifiant le changement en Bremontier (CE, 20 janvier 1988, Bremontier, p. 25).
Le dernier point à signaler sur la francisation est la proportion déclinante de changement de patronymes israélites. Après le deuxième conflit mondial et ses tragédies, 2000 changements de nom ont été accordés entre 1945 et 1957 sur ce fondement (64 % des demandes en 1950). Le nombre de telles demandes avoisinait encore une centaine par an en 1978 (11 % du total). Il est résiduel aujourd’hui.
Le caractère ridicule ou incommode d’un nom
Le deuxième fondement des changements de nom est le caractère incommode ou ridicule du nom. Cette catégorie est ancienne. Elle est souvent très objective, parfois très subjective. Objective quand, malgré l’ancienneté de la procédure, il subsiste encore des personnes sollicitant un changement de nom tel que Cocu, Vérole, Chaucouillon, Grosbidet ou Baisolit. Mais cette appréciation est parfois subjective. La Section du Sceau et le Conseil d’Etat tiennent alors compte des circonstances de temps et de lieu et notamment du métier exercé. Ainsi le Conseil d’Etat a accepté de débarrasser de leur nom : M. Vieilledent en considération de son métier de dentiste, M. Bourreau médecin, M. Danger pharmacien…
Dans cette catégorie de noms incommodes ou ridicules, entrent des changements de noms odieux ou déshonorés. Ces cas sont rares, avec par exemple des dossiers Landru ou récemment des dossiers Fourniret, quelques personnes ne supportant plus de porter le nom de ce criminel sexuel multirécidiviste.
Le relèvement ou la consécration d’un nom illustre
Le troisième motif de changement de nom réside dans le désir de consacrer un nom illustre ou de relever un nom appelé à disparaître. Cette voie s’ajoute à la procédure particulière prévue par la loi du 2 juillet 1923 pour le relèvement du nom des citoyens morts pour la France. Ici la reprise d’un nom en raison de son illustration peut-être demandée sur le fondement de l’intérêt légitime mentionné au 1er alinéa de l’article 61. Elle n’est alors pas subordonnée à la condition que ce nom ait été porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4ème degré. Cette condition s’applique seulement aux demandes fondées sur le souhait d’éviter l’extinction d’un nom fondé sur le 2ème alinéa de l’article 61.
De telles demandes doivent s’accompagner de la preuve du caractère illustre du nom. Il est fréquent, comme le relevait François Bernard, que les demandeurs confondent honorabilité et illustration, notoriété et gloire. Ces requérants ne comprennent pas toujours les exigences d’une jurisprudence qui refuse de relever un nom mentionné sur une plaque de rue dans un village.
Une récente demande illustre cette confusion. M. Lefebvre prétendait reprendre le nom d’un de ses ancêtres, M. Ripaud de Montaudevert, corsaire. Un refus lui a été opposé par la DACS. Saisi au contentieux, le Conseil d’Etat a confirmé cette décision estimant que « le nom dont la reprise était demandée, malgré la notoriété acquise par François Ripaud de Montaudevert, n’a pas été illustré sur le plan national » (CE, 24 mai 2006).
Les dispositions de l’article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement d’un nom en voie d’extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom, ou, si tel n’est pas le cas, que les plus proches descendants ou collatéraux aient donné leur accord à ce changement (CE, 19 mai 2004, Consorts Bourbon). C’est seulement lorsqu’elle est saisie de demandes concurrentes ou d’oppositions au changement demandé que la Section du Sceau peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en compte un tel critère pour accorder ou refuser le relèvement demandé. En cas d’accord, le procédé retenu est soit celui de l’addition du nom, soit celui de la substitution.
Récemment des changements de nom ont été accordés pour consacrer ou relever divers noms illustres : de Talleyrand-Périgord (de Pourtalès de Talleyrand-Périgord) par décret du 13 octobre 2005 alors que ce nom n’était plus porté par personne ; Barrière (Desseigne-Barrière) ; Clérel de Tocqueville (Clérel de Tocqueville d’Hérouville) par décret du 13 décembre 2004, l’intéressé était l’arrière petit-fils d’Alexis Clérel de Tocqueville. En la matière, le caractère restrictif du droit des changements de nom semble traduire la maxime de la Rochefoucauld : « Loin de les élever, les grands noms abaissent ceux qui ne peuvent les soutenir ».
Au titre du motif du nom illustre, le Conseil d’Etat juge depuis longtemps que constitue un motif légitime la transmission d’un pseudonyme à transformer en patronyme. Pour s’en tenir aux seuls académiciens français du siècle passé, on relève Anatole Thibaud (Anatole France), André Herzog (André Maurois), Louis Farigoule (Jules Romain), Petiot (Daniel Rops), Jacques Talagrand (Thierry Maulnier) ou Pierre Mathieu (Pierre Emmanuel).
La plupart des hommes illustres ne demandent pas pour eux-mêmes la transformation de leur patronyme qui leur serait alors accordée. Ils n’en ont pas besoin. Ce sont les générations ultérieures qui les sollicitent. S’appliquent alors les règles sur les noms illustres.
Ces dernières années, plusieurs demandes ont été adressées à la Section du Sceau pour consacrer des pseudonymes. La Section y a parfois fait droit. Ces demandes concernaient surtout des personnalités médiatiques : Patrick Bruel, Dany Boon, Patrick Poivre d’Arvor… On est là loin des exemples de l’après guerre où de Hautecloque était devenu Leclerc de Hautecloque et Ascher avait pris le nom de Ravanel.
Les demandes fondées sur la possession d’état
L’intérêt légitime peut résulter de la possession d’état. Contrairement à l’opinion commune, la jouissance d’un patronyme est bien sûr insuffisante à elle seule pour changer de nom. La jurisprudence du Conseil d’Etat exige que cette possession soit établie sur au moins trois générations qu’elle soit constante, non contestée et évidente. Ce n’est donc qu’au niveau de petits enfants qu’elle pourra être consacrée. C’est l’idée simple que nul ne peut créer son propre état-civil.
Les incidences de la loi du 4 mars 2002 modifiée sur la pratique de la Section du Sceau
La loi du 4 mars 2002 est relative au nom de famille. Elle a été modifiée par la loi du 18 juin 2003. Elle est, ainsi modifiée, entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Cette loi modifie les règles de dévolution du nom de famille. L’étude de ces règles ne constitue pas l’objet de la présente communication. Il convient néanmoins de s’interroger sur ses éventuelles incidences sur les changements de nom.
La loi du 4 mars 2002
La loi du 4 mars 2002 substitue à la règle coutumière de transmission du nom du père la possibilité pour les parents d’attribuer à leur premier enfant commun soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux dès lors que sa naissance est postérieure au 31 décembre 2004. Ce choix se fait par déclaration conjointe devant l’état civil.
Cependant est maintenue, à défaut de choix, la dévolution du nom du père si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents. Le nom choisi s’impose aux autres enfants communs. Dans le cas contraire, l’enfant porte le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier lieu.
Ce même dispositif est prévu par la loi concernant les enfants naturels.
Enfin le législateur a prévu un régime transitoire. Jusqu’au 30 juin 2006, la loi permettait aux parents, par déclaration conjointe, de demander au bénéfice de l’aîné de leurs enfants communs, nés entre le 2 septembre 1990 et le 30 juin 2006 inclus, d’adjoindre à son nom d’origine, en seconde position, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien.
Les incidences de la loi du 2 mars 2002 sur la pratique de la Section du Sceau
Le premier bilan à faire de la loi du 2 mars 2002 est celui de son application générale. Pour l’année 2005, un peu moins de 40 000 déclarations de choix d’un double nom ont été faites (soit 4,8 % des naissances. Ce taux atteint près de 10 % dans les couples étrangers ou mixtes). Dans 81 % des cas, le nom retenu est celui du père avec celui de la mère accolé. Il s’agit à 79 % de naissances hors mariage. L’INSEE n’a pas encore fait de statistiques sur l’application du dispositif transitoire qui vient seulement de se clore.
A la suite de cette loi du 2 mars 2002, la Section du Sceau a reçu des demandes tendant à l’adjonction du nom de la femme (et hors les cas où ces demandes visent au relèvement d’un nom illustre ou s’inscrivent dans le cadre d’un remariage). Ces demandes ont souvent correspondu à des noms patronymiques simples auxquels les intéressés souhaitaient ajouter un nom d’épouse à particule.
La Section du Sceau a fait une interprétation littérale de la loi du 2 mars 2002. Celle-ci avait pour objet de fixer de nouvelles règles de dévolution du nom et non, hormis la période transitoire, de modifier les règles d’adjonction. En cela, la loi ne remet pas en cause le principe d’immutabilité du nom. Cette orientation a été renforcée par la modification opérée par la loi du 18 juin 2003 qui a supprimé la faculté reconnue à l’enfant devenu majeur de modifier son nom de famille. En conséquence, la Chancellerie n’a pas modifié sa pratique ancienne. Elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la majorité des demandes. Elle n’y a fait droit que lorsque l’adjonction était un moyen d’atténuer la consonance étrangère d’un nom (Elalouf en Elalouf-Jabton).
La Chancellerie a ainsi veillé à ce que la loi du 2 mars 2002 ne conduise à des changements « affectifs ». Bien sûr, conformément à la jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat, cela ne veut pas dire qu’il n’est jamais fait droit à des demandes pour des motifs affectifs. François Bernard rappelait en 1978 que le Conseil d’Etat avait fait évoluer sa pratique initialement réticente en recherchant la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Il avait de ce fait dégager des solutions libérales notamment lorsque l’enfant déclaré sous le nom du père n’avait pratiquement jamais connu celui-ci, qui avait quitté le foyer et s’était désintéressé de l’enfant.
Ces demandes sont aujourd’hui malheureusement en augmentation du fait de l’éclatement de la cellule familiale, des divorces et des remariages. La Section du Sceau les instruit avec une grande vigilance et y fait droit, en fonction de l’intérêt de l’enfant, dans les circonstances restrictives où celui-ci n’a à peu près pas connu son père.
Il est aussi fait droit aux demandes de changement de non dans les situations difficiles dans lesquelles le titulaire du nom a été sexuellement violenté par son père ou battu par celui-ci. Le contrôle de la section du sceau est très rigoureux sur les éléments notamment médicaux accompagnant ces demandes. Il y a bien sûr là un « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil. Ces demandes hier presque inexistantes sont aujourd’hui plus nombreuses. Elles correspondent à une évolution de notre société dans laquelle ces questions ne sont plus toujours tues et cachées comme elles l’étaient hier.
* * *
En conclusion, et pour être complet, il faut dire quelques mots des dispenses en vue du mariage. La Section du Sceau instruit en effet ces demandes qui concernent les empêchements au mariage ou les mariages posthumes (depuis la loi du 31 décembre 1959 consécutive à la rupture du barrage de Malpasset). Dans les deux cas, c’est le Président de la République qui est compétent pour octroyer la dispense.
En 2005, la Section du Sceau a reçu 91 demandes de dispenses (81 à titre posthume, 10 pour empêchement). Il a été fait droit à 50 % de ces demandes, ceci dans chacune des catégories (soit 40 mariages à titre posthume, 5 pour empêchement)..
* * *
Pour conclure, vous aurez compris la situation du directeur des affaires civiles et du sceau dans tous ces dossiers de titre nobiliaire et de changement de nom il doit veiller à assurer l’héritage de notre histoire et la bonne application des règles. Pour résumer cette action, je voulais jusqu’à vendredi dernier vous dire que le directeur doit faire sienne la devise de Guillaume d’Orange.
J’ai réticence à faire ce renvoi aujourd’hui. « Je maintiendrai » a trouvé une si belle place sur l’épée de Monsieur le Président Mazeaud qu’il est déplacé que j’y fasse référence. En outre la Haye et sa Cour internationale de justice m’ont déjà emprunté pendant 17 ans mes parents ; ce serait finir par faire beaucoup d’honneur au royaume de Hollande que de multiplier les références le concernant. Permettez-moi donc tout simplement pour clore mon propos de vous dire ma gratitude de m’avoir accueilli. Je vous remercie beaucoup.